Focus sur l’éthique fiscale : plus de transparence apporte-t-elle réellement plus d’honnêteté ?
L'économiste Johannes Lorenz analyse la transparence et la morale fiscale en Allemagne. Résultats et mesures politiques en matière d’évasion fiscale.
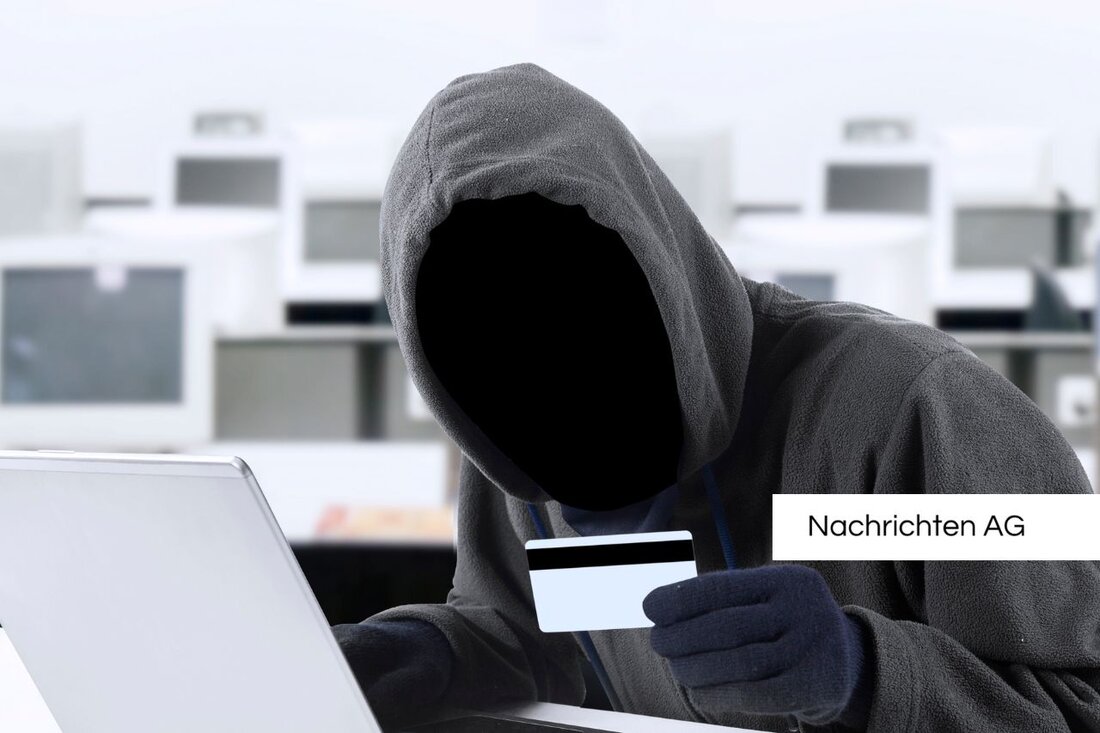
Focus sur l’éthique fiscale : plus de transparence apporte-t-elle réellement plus d’honnêteté ?
Le débat sur l’éthique fiscale et la transparence est devenu de plus en plus au centre des débats sociaux et politiques ces dernières années. L'économiste Johannes Lorenz étudie si une transparence maximale concernant les données sur les revenus personnels pourrait favoriser la conformité fiscale des citoyens. Dans son étude actuelle, basée sur les résultats de recherches antérieures, il constate qu’une plus grande transparence n’entraîne pas nécessairement une augmentation des recettes fiscales. Ceci est particulièrement important dans le contexte de la culture fiscale allemande, où l’idée de rendre publiques les données fiscales est perçue comme inhabituelle.
Compte tenu de l’ampleur de l’évasion fiscale en Allemagne, qui, selon les estimations de l’Université de Londres, s’élevait à plus de 125 milliards d’euros par an en 2019, la question se pose de savoir si une publication plus large des données sur les revenus et les impôts pourrait réellement avoir un impact positif sur la conformité fiscale. Lorenz, qui travaille comme chercheur dans le domaine de recherche spécial « Comptabilité pour la transparence » à l'Université de Paderborn, analyse dans son étude différents scénarios de transparence fiscale.
Approches et résultats de l’enquête
Pour son analyse, Lorenz a développé un modèle de réseau « petit monde ». Dans ce modèle, un quartier fictif de 1 000 habitants est simulé sur une période de 40 ans. Dans cette simulation, les habitants peuvent estimer les revenus de leurs voisins, par exemple en fonction de la taille de leur maison ou du choix des automobiles qu'ils possèdent. Le modèle suppose également une probabilité de contrôle de 5 % par an par l'administration fiscale.
Lorenz a testé trois scénarios différents : Dans le premier scénario, dans lequel aucune donnée fiscale n'est publiée, la fraude fiscale est courante parce que les gens ne savent pas ce que font leurs voisins. Dans le deuxième scénario, où le revenu imposable est publié, une pression sociale apparaît. Les citoyens qui apprennent que leurs voisins paient moins d’impôts ont tendance à agir plus honnêtement. Enfin, le troisième scénario, avec une transparence maximale, montre que la majorité des contribuables optimisent leurs impôts en toute légalité, car la peur d'être détectés et sanctionnés en cas d'évasion fiscale les empêche de nombreux actes frauduleux.
La principale conclusion de cette étude est que la transparence partielle génère les recettes fiscales les plus élevées. Alors qu’une transparence maximale conduit à la légalisation des stratégies d’évasion fiscale, une divulgation modérée est plus efficace pour minimiser les pertes fiscales. Lorenz a annoncé qu'il affinerait davantage le modèle dans les études futures.
Cadre réglementaire pour l’évasion fiscale
Le StUmgBG, qui poursuit l'objectif d'une plus grande transparence, étend les obligations de coopération des contribuables et ouvre la voie à de nouveaux pouvoirs d'enquête pour les autorités fiscales. En outre, la directive (UE) 2011/16 promeut l'échange automatique d'informations en matière de fiscalité transfrontalière. D’autres mesures, telles que la loi sur la défense contre les paradis fiscaux et la loi de mise en œuvre de la directive sur la fiscalité minimale, témoignent de la volonté politique d’agir activement contre l’évasion et la fraude fiscales.
Les défis et opportunités découlant de la combinaison de la recherche et de la réglementation montrent qu’une approche multifactorielle est nécessaire pour lutter efficacement contre l’évasion fiscale. Désormais, le débat sur la transparence fiscale, soutenu par des recherches empiriques et des cadres juridiques, continuera de gagner en importance.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto